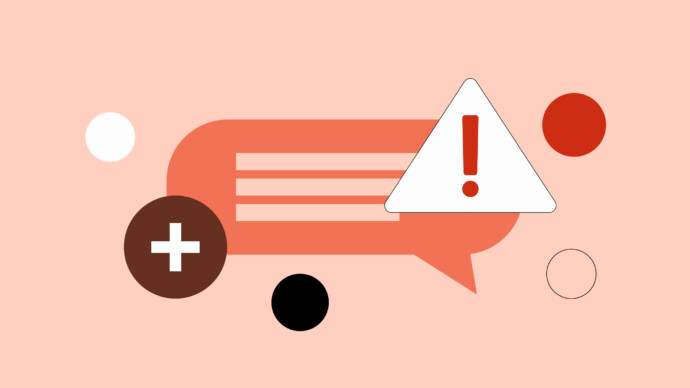
49 % des médecins interrogés sur Sermo déclarent que la désinformation nuit à la confiance, ce qui rend plus difficile l’orientation des patients vers des soins fondés sur des données probantes. Tel est le message des médecins interrogés sur Sermo, et il sous-tend un défi qui devient autant une question de communication qu’une question de faits cliniques.
Le Journal of Medical Internet Research définit la désinformation en matière de santé comme « une allégation fausse ou trompeuse liée à la santé qui n’est pas fondée sur des preuves valables ou des connaissances scientifiques ». Toutefois, dans un paysage numérique où les connaissances scientifiques sont remises en question, où les émotions motivent les clics et où la confiance est fragile, les limites s’estompent rapidement. La désinformation, en revanche, désigne des informations inexactes ou fausses qui sont diffusées sans intention de tromper, souvent par des personnes bien intentionnées qui ne se rendent pas forcément compte que le contenu est incorrect.
Selon les médecins, à quoi ressemblera la désinformation en 2025 ? Comment cela modifie-t-il leur pratique ? Et que font-ils concrètement pour y remédier ?
Cet article explore ces questions en utilisant les données exclusives du sondage Sermo, les commentaires des membres et les informations du Journal of Medical Internet Research.
À quoi ressemblera la désinformation médicale en 2025 ?
En 2025, des plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram et Twitter comptent parmi les sources les plus influentes de désinformation médicalesur les médias sociaux. Et souvent, ces informations sont erronées.
De plus en plus de recherches mettent en évidence l’ampleur de ce problème :
- Jusqu’à 51 % des messages relatifs aux vaccins contiennent des informations erronées.
- En ce qui concerne le contenu de COVID-19, près de 29 % des messages étaient inexacts.
- En ce qui concerne les messages sur les pandémies en général, les informations erronées sont présentes dans 60 % des cas.
- Même YouTube, dont la modération est censée être stricte, affiche des taux de désinformation de 20 à 30 % dans les vidéos sur les maladies infectieuses émergentes.
- Environ 44 % des messages médicaux sont des informations erronées sur la santé sur TikTok.
Et cette désinformation ne reste pas en ligne : selon un petit segment de médecins sur Sermo, 49 % des médecins interrogés déclarent que la désinformation érode directement la confiance, ce qui rend plus difficile l’orientation des patients vers des soins fondés sur des données probantes. Par ailleurs, 17 % d’entre eux affirment que les patients citent régulièrement des mythes en ligne lors de leurs consultations. Toutes ces situations modifient la manière dont les médecins doivent s’adresser aux patients et créent des obstacles à la confiance que les médecins ont de plus en plus de mal à surmonter.
Pourtant, il ne s’agit pas toujours de mauvaises nouvelles. De manière peut-être contre-intuitive, 15 % des médecins de Sermo affirment que lorsque la désinformation provoque des tensions, le fait d’écouter d’abord peut en fait renforcer la confiance. Lorsque les médecins font preuve d’empathie, même les conversations difficiles peuvent créer un espace de connexion et de confiance.
En outre, seuls 9 % des médecins affirment que les patients perdent confiance lorsque leurs croyances sont rejetées d’emblée. Cela indique que ce n’est pas la désinformation elle-même qui cause le plus de dégâts, mais plutôt la façon dont les cliniciens y répondent. S’ils sont trop énergiques ou trop rapides, leurs patients risquent tout simplement de ne plus les écouter.
La pression du temps est également un facteur sous-jacent. Seuls 10 % des médecins déclarent explicitement que la désinformation leur fait perdre du temps clinique, alors que 49 % d’entre eux affirment qu’elle érode la confiance. Ce décalage suggère que les médecins sous-estiment l’impact du temps sur leur capacité à traiter la désinformation. Il montre également que ces médecins perçoivent l’érosion de la confiance comme un problème plus fondamental que la perte directe de temps. Il faut du temps pour instaurer la confiance, et le système ne l’accorde pas toujours.
Et puis il y a la question de la définition. Tous les médecins ne sont pas d’accord sur ce qui constitue une désinformation. Qui définit la « désinformation » ? a demandé un membre de Sermo travaillant en médecine d’urgence. « Vous ne pouvez certainement pas faire confiance à la FDA, au CDC et à Big Pharma. Un autre membre, chirurgien orthopédique, avait une vision plus simple de la désinformation : « Appelons les choses par leur nom : des mensonges !
Cette absence de consensus laisse entrevoir une complexité plus profonde. La désinformation est un espace contesté, même parmi les professionnels de la santé. Certains y voient une confusion dans l’esprit du public. D’autres affirment qu’il s’agit d’une preuve de la méfiance du public à l’égard des institutions. Pour beaucoup, ce sont les deux à la fois.
L’impact de la désinformation sur la pratique clinique
Près d’un quart des médecins interrogés par Sermo (23 %) affirment que la désinformation en matière de soins de santé a créé des problèmes de confiance avec les patients et qu’il est donc plus difficile de s’assurer qu’ils suivent des traitements fondés sur des données probantes.
Mais les dommages ne se limitent pas à la confiance. Pour 38 % des personnes interrogées par Sermo, la désinformation fait perdre du temps qui pourrait être consacré au traitement. Au lieu de discuter des plans de soins ou des symptômes, les médecins sont entraînés dans des conversations visant à démystifier de fausses croyances, dont certaines sont profondément enracinées dans l’identité ou la communauté du patient. Comme il s’agit de récits auxquels les gens s’accrochent à propos de leur identité personnelle, les défaire est un travail de longue haleine.
Par ailleurs, 24 % des personnes interrogées affirment que la désinformation accroît les réticences à l’égard de traitements éprouvés tels que les vaccinations. Et si seulement 10 % d’entre eux mentionnent le fardeau que représente le fait de se tenir au courant des dernières faussetés, ce chiffre ne représente probablement pas la véritable charge cognitive. Entre la charge de travail, l’administration et les soins aux patients, les médecins sont à bout de souffle. Ajouter la tâche de démystifier à certaines rencontres avec les patients ne fait qu’augmenter les enjeux. Lorsque les patients retardent ou refusent les interventions fondées sur des données probantes, il en résulte souvent de moins bons résultats en matière de santé et des cas plus complexes au bout du compte.
Et puis il y a le défi interne. Même certains médecins se laissent prendre par la désinformation. Au Népal, 41 % des professionnels des soins oculaires pensaient que les boissons chaudes pouvaient tuer le COVID-19, ce qui révèle des lacunes dans la formation et l’accès à des informations fiables.
Même le mot « désinformation » fait l’objet d’un débat parmi les médecins. Comme l’a fait remarquer un ophtalmologiste , « même le terme ‘désinformation’ a dû être démystifié ». Dans le paysage actuel de l’information fragmentée, ce qui est considéré comme un fait dépend autant de la confiance que de la science, et tout le monde n’est pas d’accord sur la question de savoir où se situe cette confiance.
Faire face à la désinformation en matière de santé : Que doivent faire les médecins ?
Lorsque la désinformation s’invite dans la salle de consultation, les médecins savent que les faits seuls ne suffisent pas. Alors que 20 % des membres de Sermo déclarent que fournir des explications claires et fondées sur des données probantes est leur stratégie la plus efficace, les approches les mieux classées sont liées à la manière dont l’information est transmise. 35 % affirment que l’écoute active est essentielle et 30 % soulignent l’importance d’un ton calme et sans jugement. Cela fait écho au fait que la confiance se construit par la présence et l’empathie plutôt que par l’ exactitude.
12 % des médecins déclarent utiliser des analogies pour simplifier une science complexe, une tactique qui reste sous-utilisée. Dans un monde numérique où la désinformation est percutante et facile à digérer, les analogies aident à combler les lacunes de la communication. Elles peuvent transformer l’ambiguïté en quelque chose de saisissable. Mais malgré leur potentiel, peu de médecins y recourent instinctivement.
Seuls 4 % d’entre eux s’appuient sur le partage de ressources fiables, un chiffre qui en dit long. Dans un monde où la désinformation est omniprésente, les gens ont besoin de voir le professionnel qui se cache derrière la « ressource » pour faire confiance à ce qu’il a à dire personnellement. En 2018, 95 % des patients déclarent faire « un peu » ou « beaucoup » confiance aux médecins. Même l’article le plus précis ne fera pas le poids s’il est transmis par quelqu’un en qui le patient n’a pas entièrement confiance.
Stratégies utilisées actuellement par les médecins
Lorsqu’on leur a demandé ce qui les aiderait le mieux à lutter contre la désinformation, les médecins interrogés par Sermo n’ont pas réclamé plus de technologie. Seuls 4 % d’entre eux ont privilégié les outils numériques, tandis que 33 % ont donné la priorité à la formation continue. Cette distinction suggère que les médecins veulent des compétences de communication pratiques qu’ils peuvent utiliser sous pression.
Presque autant (31 %) ont déclaré que les campagnes de santé publique étaient essentielles. Cela montre que les médecins veulent entrer dans une pièce avec des patients déjà mieux informés. Selon eux, la lutte contre la désinformation ne peut pas reposer uniquement sur des consultations individuelles et doit commencer à un stade plus avancé du parcours du patient, par le biais des médias et de l’éducation du public.
Il est intéressant de noter que seuls 14 % d’entre eux ont demandé une réduction de la charge de travail. Cela ne veut pas dire que le temps n’est pas un facteur, il l’est clairement, mais la plupart des cliniciens savent que le système n’est pas prêt de ralentir. Au lieu de cela, ils demandent un soutien qu’ils peuvent recevoir de manière réaliste : une formation et des ressources.
Quel soutien plus large les médecins souhaitent-ils ?
Les médecins regardent également au-delà de la clinique. Lorsqu’on leur demande comment établir un partenariat efficace avec les dirigeants de la communauté, 26 % répondent que les médias locaux devraient jouer un rôle plus important. Cela montre que l’on reconnaît de plus en plus que la confiance du public est façonnée autant par les organes d’information et les voix locales que par les références médicales.
Les éducateurs suivent de près, avec 22 % de soutien. Les écoles et les universités offrent la possibilité d’atteindre les gens à un stade précoce, avant que les fausses croyances ne s’installent. Les médecins pensent à long terme et sont nombreux à prôner la prévention. Si 21 % d’entre eux sont favorables à l’organisation d’ateliers avec des personnes influentes, ils sont moins nombreux à approuver le partage passif d’informations. Les médecins reconnaissent l’importance d’une discussion plutôt que d’une simple diffusion. La visibilité a donné de l’espace à la désinformation, de sorte que les médecins cherchent maintenant des moyens de mettre en valeur leur crédibilité, et ils veulent des partenaires qui les aideront à y parvenir.
Ce que vous pouvez en tirer
Les médecins de Sermo affirment que la lutte contre la désinformation en matière de soins de santé passe par l’instauration d’un climat de confiance grâce à la communication et à l’implication de communautés plus larges. L’écoute, l’empathie et la collaboration publique s’avèrent plus efficaces que les seuls faits. Des cliniques aux salles de classe en passant par les médias locaux, la solution semble être plus sociale que scientifique.
